-
Joël Gayraud, de passage public
 Jean-Claude Leroy Joël Gayraud
Jean-Claude Leroy Joël Gayraud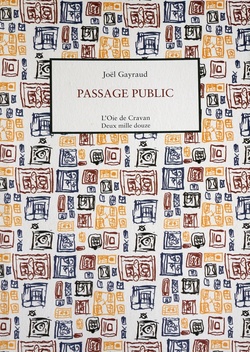 « La formule pour renverser le monde, nous ne l’avons pas cherché dans les livres mais en errant. C’était des dérives à grande journée où rien ne ressemblait à la ville, et qui ne s’arrêtait jamais. »
« La formule pour renverser le monde, nous ne l’avons pas cherché dans les livres mais en errant. C’était des dérives à grande journée où rien ne ressemblait à la ville, et qui ne s’arrêtait jamais. »
Guy Debord,
In girum imus nocte et consumimur igni
À lire Passage public on n’a pas vraiment l’impression que Joël Gayraud ait grand-chose à voir avec la société clinquante, l’économie rentable, le devenir social, et c’est heureux bien sûr ; on l’imagine plutôt de ces têtes nomades, faussement paresseuses, s’appliquant à vivre in petto le temps qui passe, et relevant ça et là les signes apparents d’un ordre invisible qui saille parfois à travers le rire de flâneurs surpris, comblés. Errant de par le monde, dans une ville ou dans une autre, dans un quartier ou dans un autre, il s’amuse d’un rien qui n’est pas un rien, d’un souvenir qui se pointe, d’un hasard ironique. Il s’amuse ou se souvient, réfléchit en observant, et même se fait grave à l’occasion. Une souple érudition le transporte à souhait, sans jamais le diriger, et son errance savourée nous sert de guide.
Régal que ces sorties sur terre, qui sont parfois des « sorties de route », comme quand la chose est avalée à côté de la raison, par le conduit de la fantaisie questionnante, de quoi faire écrire à Gayraud : « si j’étais moi, je me méfierais. » Le plus souvent, toutefois, on se retrouve véritablement témoin dans un coin de zone urbaine, au Pirée, à Uzerche, Naples ou Paris (Paris qu’il décrit en « puits profond de deux millénaires, dont la margelle est le boulevard périphérique »). Ou encore au cimetière des Capucins, à Rome, où est présenté au visiteur, « avec ses accumulations de crânes, ses frises de clavicules et de spondyles, ses lampadaires en dentelle de tibias et de côtes, ses longs envols tout battants de pelvis au flanc des voûtes, le plus vibrant hommage de l’art baroque à l’idée de la mort. L’emploi des ossements comme simples éléments d’ornementation, sans la moindre considération pour leur origine, est là pour nous rappeler cruellement la perte définitive d’individuation qui suit la fin de la vie. »
Au Pirée, en bordure de la rue Argyrokastro, la rue du Château d’argent, une masure dont le mur de façade a en partie disparu, un homme semble l’habiter, il punaise sur une des poutres une photo de magazine. Des chiens suivent l’homme jusqu’à une vieille Fiat 1300 immobilisée, maculée d’inscriptions et de dessins d’animaux ; le toit est soigné de peinture verte, dominé par un téléviseur peint de la même couleur. Notre guide-narrateur parle de cet ensemble comme d’un chef-d’œuvre de l’art brut tandis que l’homme prend un pinceau, de la peinture, et recouvre de nouvelles marques le « palimpseste perpétuel ». Les chiens signalent soudain par leur excitation l’arrivée d’un lent cortège de voitures décorées de couronnes de roses pourpres, et dont les passagers et chauffeurs sont expressément hilares. La fête rampante est pour le moins étrange. Il faut le dernier véhicule, une spacieuse limousine dont l’arrière est encombré d’un long cercueil, pour deviner qu’il s’agit là, à coup sûr, d’un cortège funèbre. C’est ailleurs, quelque part dans Paris, du côté de la station Maison blanche, que notre cicérone réalisa que « le souvenir d’un rêve [venait de prendre] pour quelques instants la place de toute la réalité », alors qu’à ce moment, au Pirée, rue du Château d’argent, en présence d’un fou éclairant escorté de quelques bâtards sereins, entre le geste de créer et un regard infini porté au passant égaré, sur fond de passage d’un enterrement carnavalesque, c’était la réalité attrapée qui faisait concurrence à l’espièglerie des rêves.
Poète et traducteur de l’italien (Léopardi, Agamben, etc.), Joël Gayraud avait notamment publié il y a quelques années aux éditions José Corti un remarquable ensemble de notes et réflexions, La peau de l’ombre, révélant la patte d’un lecteur implacable en même temps qu’analyste sensible. Le voici aujourd’hui maître d’un petit ouvrage que le bonheur ne jettera qu’entre les mains de rêveurs des plus avisés. Dix-sept proses brèves, comme autant des cartes postales rédigées d’une main précise et d’un œil embarqué par l’esprit.
Joël Gayraud
Passage public
L’Oie de Cravan, 2012.
11 €, en libraire
(distribution Belles Lettres) Tags : joel gayraud
Tags : joel gayraud
jean-claude leroy
